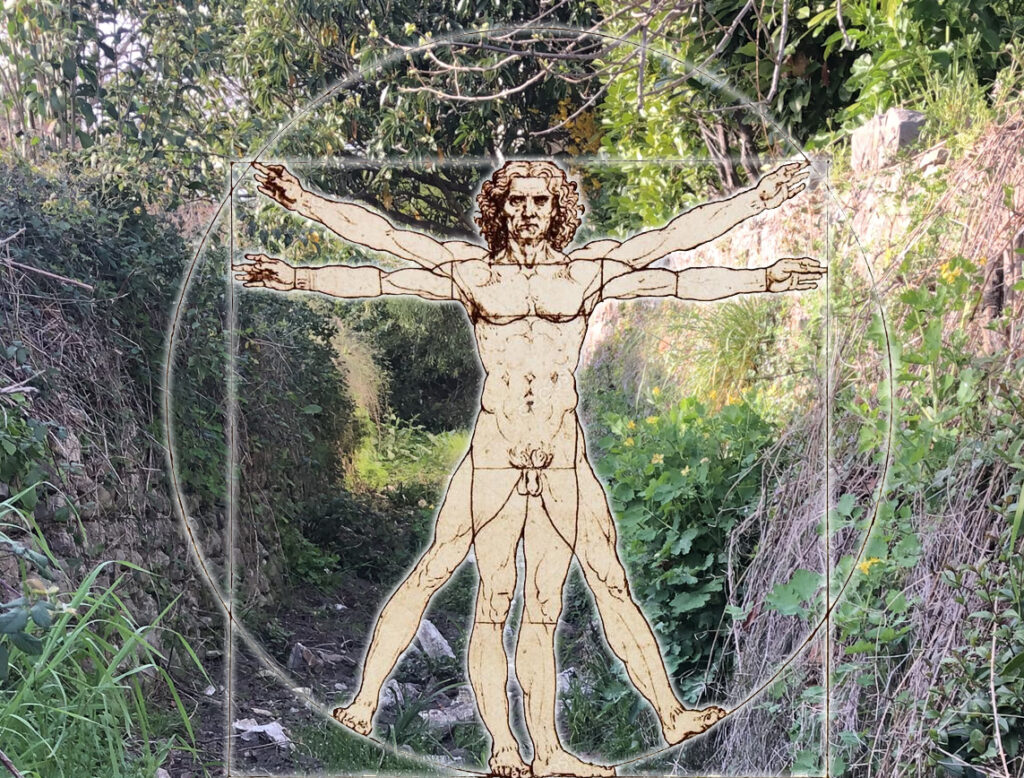Toute l'histoire ... passionnante !
En arpentant Saint-Hippolyte, il suffit de lever les yeux ou de se pencher sur une rigole pour sentir qu’ici l’eau n’a jamais cessé d’être affaire d’ingéniosité, de pouvoir et de mémoire.
L’Agal, que l’on prend trop souvent pour un simple béal de moulin, s’avère à bien des égards un fil d’Ariane hydraulique qui traverse les siècles. Sa couverture, entre 1954 et 1957, a figé dans le béton un réseau dont les origines et les détournements successifs demeurent énigmatiques.
Mais dès que l’on remonte ses traces, les contradictions se multiplient et l’on comprend que rien n’est linéaire : l’Agal irrigue, actionne, défend, intrigue, et nourrit même des récits fantastiques.
Avant cette couverture, l’Agal était un canal à ciel ouvert, doublé d’un simple sentier. Sa transformation en rue fut à la fois une solution sanitaire et une opération d’urbanisme. Depuis des siècles, l’Agal était devenu pestilentiel : on y jetait les pots de chambre et l’eau croupissante empuantissait un peu plus le quartier.
Plusieurs tentatives de couverture avaient échoué, mais au milieu du XXe siècle, il ne s’agissait plus seulement de supprimer une nuisance : il fallait aussi offrir aux riverains une voirie carrossable, conforme aux besoins d’une circulation moderne. Ainsi naquit la rue de l’Agal, sans que presque personne aujourd’hui ne se souvienne qu’elle n’était, à l’origine, qu’un canal.
Et pourtant, on ne peut s’empêcher de penser qu’en la couvrant, on a aussi sacrifié un visage pittoresque de la ville. Ailleurs, on redécouvre aujourd’hui des canaux ensevelis, on les rouvre pour leur valeur patrimoniale et parce qu’ils apportent fraîcheur et respiration au cœur de l’été. Ici, l’Agal reste dissimulé, discret, presque oublié, alors même qu’il constitue un patrimoine hydraulique exceptionnel.
Son statut a longtemps fait débat. Canal d’irrigation en occitan, il fut conçu pour arroser des terres, mais quatre moulins se greffèrent bientôt sur son parcours, donnant l’illusion qu’il avait toujours été pensé comme béal. Plus tard, les fortifications vinrent à leur tour se nourrir de son débit : la citadelle dite de Vauban, en 1693, prévoyait que ses douves fussent alimentées par l’Agal avant de céder l’eau au moulin des Portes et aux installations du pré de Mandiargues.
Entre-temps, tout un chapelet de prises individuelles avait été concédé aux riverains : de la prise maîtresse jusqu’au moulin de Croye, on en comptait une centaine, dessinant une carte des droits et des usages, véritable radiographie sociale d’un temps où l’eau faisait loi.
Les ayants-droits, eux, n’ont jamais été des anges. C’était presque un sport local que de tricher : on limait l’orifice des prises pour augmenter le débit, on posait des barrages flottants en douce pour détourner plus qu’il n’était permis. Le juge de paix dut trancher lors d’un procès resté fameux, provoqué par le Baron Pieyre, et finit par rappeler le caractère « commun » de l’Agal.
À l’époque déjà, les Cigalois espéraient tirer parti de ce canal au-delà de ce qui était prévu. Plus récemment, la question de la propriété de la « chaussée » de l’Agal est revenue dans les discussions, certains invoquant encore le nom du Baron Pieyre, bien que sa famille ait quitté la région depuis une cinquantaine d’années.
Dans ce contexte, l’actuel maire, Bruno Olivieri, avait rappelé avant son second mandat son intention de rénover la rue de l’Agal, un projet que de nombreux habitants espèrent toujours voir se concrétiser.
Au détour du Vidourle, on découvre des béals si monumentaux qu’ils semblent sortis d’un autre monde, comme ceux des moulins de Planque, de Figaret, d’Espaze ou encore de Graves. À côté, l’Agal couvert paraît bien modeste.
Et pourtant, ses tronçons anciens révèlent des sections colossales : au moulin de Lasalle – en aval du fort « Vauban », l’ouvrage conserve près d’1,80 mètre de côté, laissant deviner un canal originel infiniment plus vaste que celui que l’on imagine aujourd’hui. La traversée de l’Argentesse ajoute à l’étonnement : comment l’eau pouvait-elle plonger sous la rivière pour rejaillir plus loin, alimentant le Moulin Neuf et le Moulinet ?
C’est le principe du siphon, connu depuis l’Antiquité, qui en donne la clef. L’ouvrage a été reconstruit en béton, mais l’idée, elle, reste d’une simplicité vertigineuse.
Tout autour, des indices se multiplient. Les tines, ces réservoirs antérieurs aux moulins, servaient de hubs de redistribution de l’eau du Vidourle, comme à Croye, au Moulin Neuf ou aux Portes. Leurs bassins rappellent les dispositifs antiques de diffusion par agals, avec parfois des norias disparues ou des réservoirs enterrés qui redistribuaient l’eau en étoile.
À croire qu’un savoir-faire local avait su réinterpréter un héritage bien plus ancien. Certains évoquent des parallèles avec les canalisations gallo-romaines, en terre cuite poreuse, conçues pour irriguer à grande échelle. Peut-être même qu’une graine, plantée voici deux mille ans, a germé dans nos moulins comme dans nos citadelles.
Les archives confirment que la puissance publique n’était pas seule à gérer ce trésor liquide. Les ayants droit figuraient en bonne place sur les plans de 1929, au fil d’un parcours jalonné de parcelles portant les noms de familles encore connues.
Bourguet, Mazaurin, Planchon, Carrière : autant de lignées qui, comme autant de vannes, régulaient le partage de l’eau. Plus en amont, la concession Bousquet témoigne d’un autre modèle : une fontaine monumentale doublée de sa jumelle, reliées par un conduit franchissant l’Argentesse par siphon.
Le Pavillon du Gouverneur, qui lui était associé, aurait été dès l’origine un pavillon de chasse. Mais ses installations hydrauliques frappent par leur monumentalité, au point de faire songer à une tradition antique ressurgie, dans une continuité troublante avec l’Agal.
Et parfois, le récit dévie vers l’inquiétant. Un soir, la rue de l’Agal fut barrée : des hommes en combinaison marquée du sigle radioactif déchargeaient des caisses issues de caves riveraines. La prise même du canal a depuis été obstruée par une plaque métallique, laissant seulement s’échapper quelques filets d’eau par les interstices.
On a parlé de fuites, de transmissions, d’interventions de dépollution nocturne. Certains voisins ont préféré fuir. Fantômes modernes d’un réseau où la rumeur court aussi vite que l’eau jadis.
Et comme pour ajouter une touche de farce à ce mélange d’histoire et de mystères, voilà qu’un service de la préfecture m’a récemment contacté, par le biais de la Gazette de Croix-Haute, en me traitant comme l’expert de l’Agal. Une manière de rappeler que ce patrimoine, parfois méconnu, reste d’actualité.
C’est ainsi que l’Agal se raconte, par fragments discordants et visions successives. Canal agricole, béal de moulins, douve de citadelle, archive cadastrale, réservoir antique, fardeau pestilentiel ou décor de fantasmagorie contemporaine : tout cela se superpose et se contredit parfois.
Mais c’est de cette tension que naît la richesse du récit. L’Agal n’est pas un simple canal ; il est la mémoire mouvante d’un territoire, la preuve qu’un filet d’eau peut, au fil des siècles, irriguer bien plus que des jardins : des imaginaires, des luttes, des héritages, des soupçons.
Et qu’il suffit d’écouter son murmure souterrain, qui jadis filait jusqu’au Nègue-Bouc en passant par le fort, pour voir ressurgir cette histoire.
Jeroen van der Goot octobre 2025