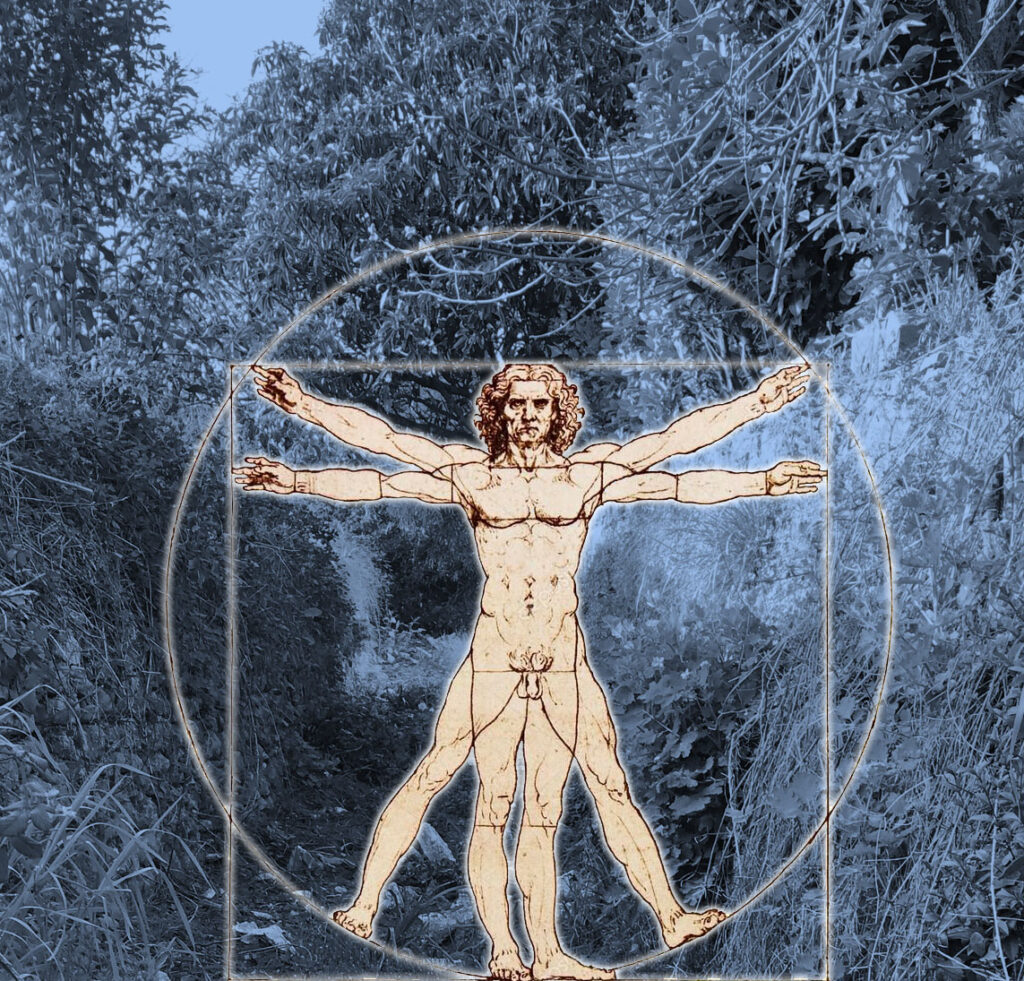L’apogée du village au fil de l’eau.
Tout commença avec les moulins hydrauliques. En découvrant leurs vestiges, je compris l’ingéniosité qui avait façonné ce territoire.
Sur les premiers plans de Saint-Hippolyte, une mention m’intrigua : « ruisseau du Vidourle ». Pourquoi « ruisseau » plutôt que « rivière » ou « fleuve » ? Pour le comprendre, il me fallut explorer la géologie locale. Le secret réside dans le karst, cette roche poreuse criblée d’interstices, qui fait disparaître l’eau pour la restituer ailleurs. C’est ainsi que le Vidourle se cache et réapparaît, notamment à Sauve, longtemps considérée comme sa source, déjà repérée par Ptolémée il y a deux mille ans.
En survolant André Peyriat, j’appris qu’on franchissait jadis le gué reliant la rue Basse au faubourg du Vidourle grâce à des bœufs. La traversée était difficile : le Vidourle s’y creusait brutalement et la vase compliquait tout. Pas de pont à l’époque, sans doute parce que la route d’Alès ne démarrait pas encore vraiment à Saint-Hippolyte, mais aussi parce que les ponts submersibles carrossables sont sans doute bien postérieurs.
On connaissait des ponts à Conqueyrac ou sur l’Argentesse, mais rien ne prouve qu’ils fussent submersibles. Certains disparurent probablement lors des grands travaux de contrôle des Cévennes sous Lamoignon de Basville.
Mais pourquoi l’eau manquait-elle au droit du gué ? Sans doute à cause d’une section karstique. Marthe Moreau me révéla par ailleurs l’existence d’un moulin oublié : le moulin Mirial, situé justement sur le gué de la rue Basse, et portant le même nom que la villa. Était-ce un hasard ? Je le crois seulement en partie. Son installation fît que l’eau était retenue en amont du gué pour la restituer en aval.
Plus largement, l’organisation des moulins force l’admiration : chacun prenait l’eau juste en aval de là où le précédent la rendait. Rien à voir avec les querelles plus récentes autour des prises d’eau de l’Agal ou des détournements clandestins de fontaines.
C’est en suivant ce fil que je découvris l’Agal, ce canal qui glisse sous la rue éponyme, passe sous l’Argentesse au fort, puis rejoint le pré de Mandiargues jusqu’au ruisseau de Nègue-Bouc. Avec Pascal Coularou, j’appris l’art des « canonnades » – ces conduites de poterie alimentant les fontaines – et des « siphons » jouant des vases communicants pour franchir les reliefs.
Plus tard, en lisant la correspondance tendue entre Jacques Pieyre et le maire André Molines, je mesurai l’ampleur du bouleversement causé par le recouvrement de l’Agal dans les années 1950 : ce réseau ancestral, soudain réduit à un conduit de béton de faible section, perdait son âme. Pourtant, en descendant dans son lit asséché au droit du moulin Lasalle, j’eus l’impression de plonger dans la romanité.
L’Agal actionnait quatre moulins : Croye, Lasalle, le Neuf (1618) et le Moulinet – ce dernier ayant disparu depuis. Au Moulin Neuf, une citerne semi-enterrée et une noria témoignent encore d’un savoir-faire étonnant. Sur le cadastre napoléonien, je relevai une inflexion étrange du tracé de l’Agal à la sortie du moulin, renvoyant clairement vers un bassin antique à l’Huis et peut-être une tine enterrée expliquant la cassure du parcours.
En poursuivant ces recherches, je découvris une fontaine publique au passage de la Baume et le dessin d’un pont devant la porte du Peirou. Nos anciens savaient mieux que nous combien les eaux pouvaient dévaler du Cengle en torrents destructeurs – souvenir d’un soir apocalyptique dans les années 80. Les remparts occidentaux, doublés d’un fossé, servaient probablement déjà très tôt à détourner ces ruissellements vers l’Argentesse et le Vidourle, bien avant les ouvrages de 1700. Mais tout cela disparut avec l’installation de l’École militaire préparatoire.
Saint-Hippolyte compta jusqu’à au moins 114 fontaines, dont j’ai pu reconstituer le tracé des canonnades. J’eus aussi la chance de visiter le mas des Jardins, où l’eau se distribuait par un réservoir souterrain, une noria, une pansière dans le Vidourle et même un canal aérien reliant le moulin des Graves.
Ces détails, en apparence techniques, révèlent en réalité un savoir-faire collectif impressionnant. Mais la trouvaille la plus incroyable fut le réseau de canonnades souterrain, qui limitait les pertes par évaporation.
Geneviève D. me fit découvrir ensuite les deux fontaines monumentales du Pavillon, sans doute parmi les plus anciennes du village, car liées à la fameuse concession Bousquet – et, là aussi, je soupçonne qu’il y avait un gigantesque réseau de canonnades enterré. Chaque projet d’adduction d’eau -qu’il s’agisse de celui depuis Cros ou du mas d’Icar – se heurta à la même difficulté : négocier avec ceux qui détenaient déjà les droits d’eau.
À ce stade, une autre facette de cette histoire s’imposa : celle du commerce de l’eau. Pendant des années, les fontaines publiques n’avaient été qu’autant de pataugeoires, noyant les abords dans la boue. On décida un jour d’y installer des bassines, ou réceptacles, afin de recueillir le trop-plein. L’avantage n’était pas seulement d’assainir le sol : l’eau récupérée put aussi être commercialisée.
Pour la Communauté, c’était un revenu régulier ; pour l’acheteur, une garantie à vie acquise pour un vil prix. Tellement vil que, pour la fontaine de Villaret, un particulier proposa de financer lui-même l’ouvrage public, en échange du droit de profiter du trop-plein. Pour amortir leur investissement, ceux qu’on appela bientôt les « égoutiers » revendirent assez vite leur surplus, donnant naissance à des sous-égoutiers, et même à des sous-égoutiers de deuxième catégorie.
Ce système, parfois digne d’une bourse des eaux avant l’heure, connut un essor particulier lorsque le village fut enfermé dans l’enceinte royale, censée contenir le « fanatisme » protestant.
Et quand on croit avoir tout vu, d’autres surprises surgissent encore : un bassin souterrain rue Carriérasses, vestige d’une carrière ; le Font de Colle, bien plus qu’un simple trou où l’on venait remplir ses cruches et pique-niquer ; des canalisations courant sur plusieurs kilomètres avec passages en siphon ; ou encore une piscine au fort, alimentée par le trop-plein d’une fontaine du Pradet.
Chaque découverte relance ainsi l’histoire, comme une source intarissable, prête à jaillir encore.
À suivre ?
Jeroen van der Goot 22 septembre 2025
Nota : Je ne voulais pas clore cette histoire sur une note de tristesse. Mais, à mes yeux, ce ne sont ni la sériciculture ni la tannerie qui incarnent les plus belles pages de notre bourg. Ce qui m’a poussé à remonter le fil de son passé, c’est l’eau.
Remerciements : Merci à tous ceux qui ont montré leur enthousiasme à la lecture de mes articles. Merci aux 21 500 signataires de ce qui fut d’abord un moyen d’exprimer un soutien aux fontaines avant de devenir une véritable pétition nationale. Merci à ceux qui ont partagé leur savoir, m’ont accueilli, invité, ou confié des documents précieux. Merci à la Gazette. Et bien sûr, un merci tout particulier à Pascal Coularou, intarissable dès qu’il s’agit de parler de Saint-Hippolyte.